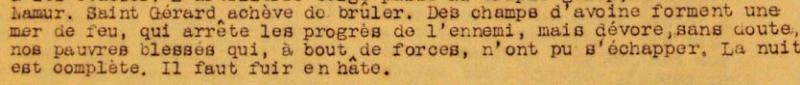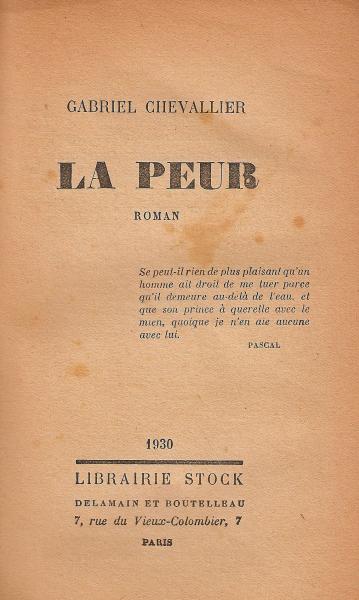Non, il y a là une généralisation de la politique de terre brulée effectivement pratiquée systématiquement en 1917 lors du recul du 16-30 Mars 1917 dans l'Aisne. En 1914, rien de systématique et comme le montrent bon nombre de témoignages, les soldats français continuèrent de trouver des animaux abandonner pendant le recul allemand suivant la bataille de la Marne. Si les Allemands avaient pratiqué cette politique, cela aurait fait l'objet de campagnes dans la presse comme ce fut le cas des massacres de civils par exemple.Lorsque les allemands reculaient ils pratiquaient la politique de la terre brulée, c'est à dire ils mettaient le feu aux fermes, abattaient les arbres fruitiers, empoisonnaient les puits et autres sources, abattaient le bétail, de sorte que les soldats alliés ne trouvaient rien pour s'alimenter ou se protéger... Ils appelaient cela le... j'ai oublié le nom...
Dans un autre témoignage, on trouve cette mention : « on continue la destruction des cultures » en septembre 1914, de la part d'un soldat français !... Inutile d'en faire ici non plus une généralisation à tout le front ! Il pourrait même s'agit ici d'un simple constat que la marche dans les champs détruits tout et non d'un ordre. Croiser les sources est la seule solution pour en avoir le cœur net.
GAGET Olivier, Un officier du 15e corps, carnets de route et lettres de guerre de Marcel Rostin (1914-1916), Saint-Michel de l'Observatoire, C'est-à-dire éditions, 2008. Page 53.
Plusieurs éléments poussent effectivement à enquêter sur cette affirmation relatée dans Chevallier. En effet, un détail semble excessif ("plusieurs centaines de blessés") et le fait que ce soit un dire rapporté par un autre homme. On sait à quel point le témoignage peut distordre la réalité.
Cordialement,
Arnaud