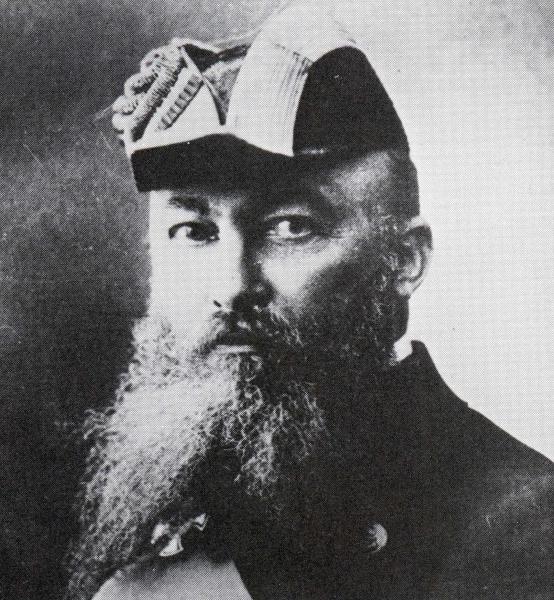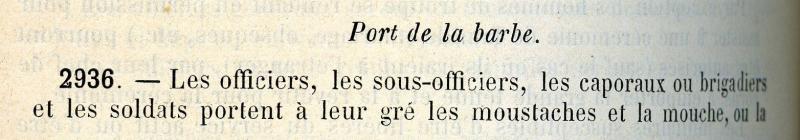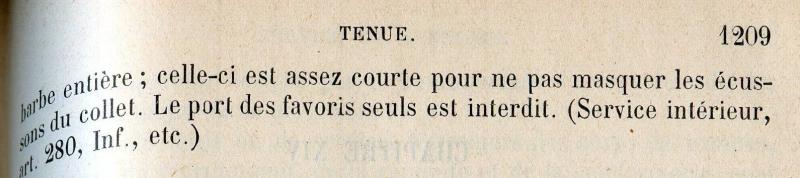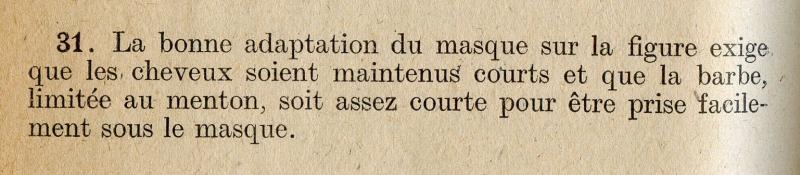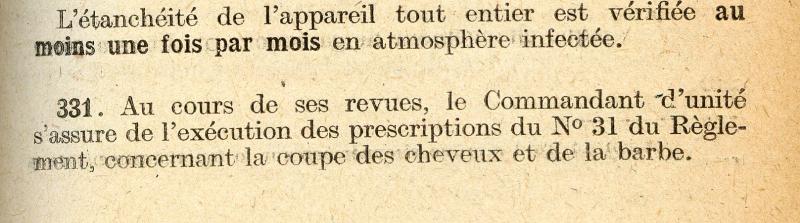Bonjour,
Ah! La question de la pilosité, de la "barbologie" ! ça peut très vite nous entraîner vers le hors sujet, le conflictuel en raison des opinions, clichés, ... Mais, c'est un sujet fort intéressant. Ainsi, je vous propose un pdf qui aborde le sujet sous différents éclairages et propose quelques lectures supplémentaires.
Bonne lecture
Geneviève
Organisations pileuses et positions politiques
À propos de démêlés idéologico-capillaires
F r é d é r i c B a i l l e t t e
Quasimodo, n° 7 (« Modifications corporelles »), printemps 2003, Montpellier, p. 121-160
Texte disponible sur
http://www.revue-quasimodo.org
[quotemsg]
http://www.revue-quasimodo.org/Quasimod ... ations.htm
page 121
l'histoire de la pilosité (de son émondage, de son arrangement,
de sa fertilité) est éminemment sociale, sexuelle, magico-
religieuse 1 et politique. Le poil, qu’il prolifère ou se dérobe,
se charge de significations fort différentes selon ses zones d’implan-
tation privilégiées et ses lieux de villégiature. « Dès qu’il pousse,
il n’y a plus de poil en soi : tout duvet est culturel. » 2
Associé à d’autres manifestations corporelles (attitudes, dégai-
nes, gestuelles, etc.) et à des assortiments vestimentaires, il peut
énoncer un engagement politique, ou accompagner un parti pris
idéologique. Il est aussi la manifestation visible, et parfois carica-
turale, d’un choix existentiel, d’une orientation ou d’une prise de
position philosophique, esthétique ou sexuelle. Le poil se fait alors,
signe de déférence, marque d’allégeance ou, tout au contraire,
manifestation caractérisée d’une effronterie, d’un irrespect, l’af-
firmation et la démonstration d’un refus. Rien d’étonnant dès lors,
comme le constate Jerzy Jedlicki, qu’« à toutes les époques, dans
toutes les cultures, le pouvoir [se soit] intéressé à la manière de se
coiffer de ses citoyens. Il voyait dans leurs cheveux et leur barbe
un symbole du soutien ou de l’opposition à son égard. Porter le
poil long ou court, c’est effectivement marquer son appartenance
au camp de la tradition ou au contraire de la révolution ». Aussi,
ce philosophe polonais, qui s’intéresse à la « dialectique du poil
et du pouvoir », propose-t-il d’appeler barbologie la discipline
cherchant « à interpréter la relation entre la barbe, et plus géné-
ralement la coiffure, et la politique, qu’elle soit gouvernementale
ou révolutionnaire. » 3 De la même manière, les individus, en
jouant de la mise en forme de leur système pileux se livrent à des
modifications de l’apparence corporelle aussi signifiantes que pro-
visoires. Ils peuvent ainsi coller à la norme corporelle – c’est-à-dire
culturelle – en respectant les codes de la pilosité à l’honneur ou au
contraire s’en affranchir et ainsi la transgresser.
1 – Cf. Edward R. Leach, « Cheveux, poils, magie », in L’Unité de l’homme et autres essais, Paris, Gallimard, 1980 ;
Philippe Lançon, « Couper sa barbe, c’est épiler Dieu », L’Événement du Jeudi, 10-16 septembre 1992, p. 82-83.
Dossier dirigé par Odile Grand : « Si le monde va mal, est-ce la faute aux barbus ? », p. 74-93.
2 – Boris Cyrulnik, Les Nourritures affectives, Paris, Éditions Odile Jacob, 1993, p. 28.
Voir également M. Lacombe, « Nature, cultures et pilosités », Sociétés. Revue des Sciences
Humaines et Sociales, n° 49 (« L’imaginaire »), 1995, Dunod, p. 295-301.
3 – Isabelle Lesniak (propos recueillis par), « Le poil gêne toujours le pouvoir », L’Événement
du Jeudi, op. cit., p. 84.
[/quotemsg]
Wittgenstein Ludwig (1889-1951). "La philosophie est la lutte contre l'ensorcellement de notre entendement par les moyens de notre langage" P.I. § 109