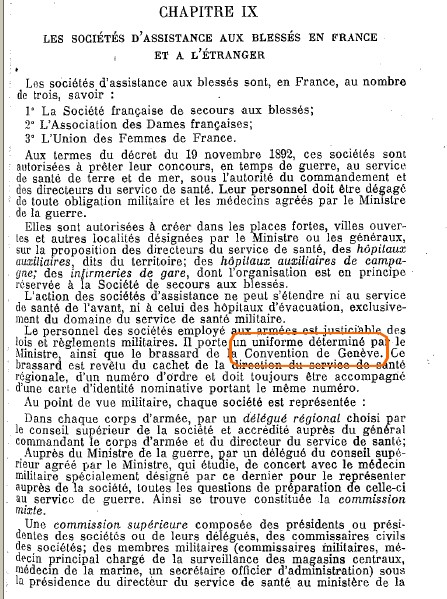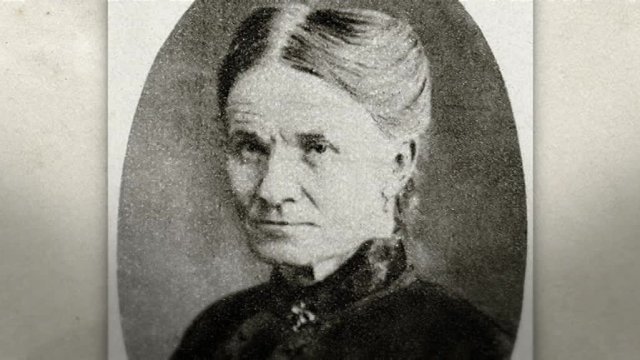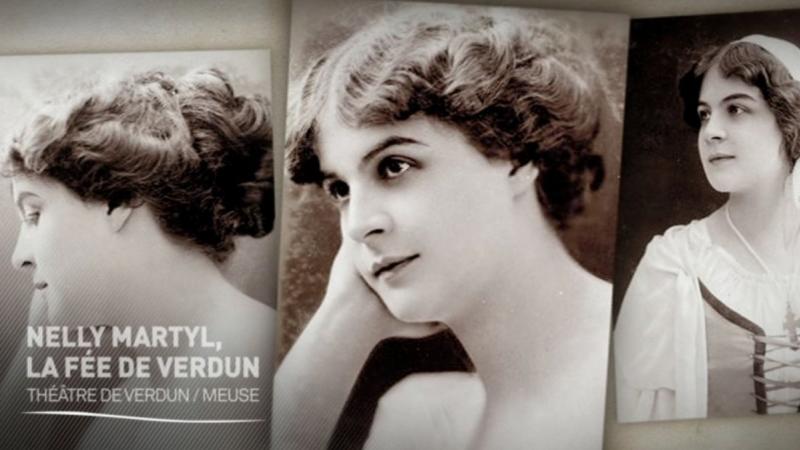*
Bonsoir à toutes et tous
"avant 1905, les infirmières en milieu hospitalier seraient toutes des religieuses ? "
La question, en apparence simple de Régis, renvoie à la complexité française.
J'ai essayé, sans

remonter au Déluge, de faire "court".
- Moyen-Age,
l’Eglise se lance dans une chasse contre les guérisseuses, appelées sorcières. Ce sont des religieuses, souvent sans connaissances particulières en matière de soins, qui prennent en charge les malades. Pendant longtemps, elles exerceront une sorte de souveraineté sur toutes espèces de soins. Parallèlement, des édifices fréquemment appelés Hôtel-Dieu, sont construits par des congrégations religieuses. Ces maisons hospitalières / hospices / hôpitaux sont destinés à recevoir aussi bien les indigents que les malades. Elles sont administrées par les autorités ecclésiastiques. Les ressources financières proviennent de dons des particuliers, des dots des religieuses. Les finances sont florissantes d’autant que le patrimoine catholique est exempté d’impôt.
- Révolution française, première tentative de laïcisation des hôpitaux,
1790, Les hôpitaux sont confisqués aux congrégations religieuses.
1792, les corporations religieuses sont dissoutes, néanmoins des membres des congrégations hospitalières peuvent continuer leur travail à titre individuel.
Décret du 11 juillet 1794, nationalisation des hôpitaux : le projet révolutionnaire était d’édifier un système d’assistance sans aucun lien avec la charité chrétienne, système qui devait être pris en charge et géré par l’Etat.
Le Directoire ne peut pas faire face au coût que cela représente pour l’Etat, il transfère la gestion des hospices civils aux municipalités (décret du 7 octobre 1796). On manque de personnel, les religieuses sont rappelées.
- Sous la 2nde République et le 2nd Empire,
presque tous les hôpitaux / hospices urbains disposent de religieuses qui assurent la surveillance, l’économat autant que les soins. Les taches ménagères subalternes étant assurées par un personnel laïc, pauvre, sans instruction et sous-payé.
Néanmoins, la suprématie exercée dans le domaine des soins par les religieuses est remise en question au milieu du 19ème siècle. La loi du 10 janvier 1849 crée l’administration générale de l’Assistance Publique de Paris. Elle est chargée de gérer les hôpitaux, hospices et secours à domicile dans cette ville. Pour la première fois, le terme « infirmière » est utilisé afin de nommer le personnel de l’Assistance Publique de Paris.
La loi du 7 août 1851 établit ce qu’on peut appeler une « 1ère charte hospitalière ». La loi précise que tous les malades, sans distinction de religion et même ceux qui sont sans ressources, doivent être admis dans l’hôpital de leur commune. Cette loi reconnaît l’existence d’établissements privés et autorise les communes qui n’ont pas d’hospices/ hôpitaux à traiter avec eux.
Au milieu du XIXe siècle, l'idée de laïcisation du personnel est en marche, des laïques sont déjà venues se joindre aux religieuses: on compte 4000 « « infirmières » laïques pour 7600 religieuses. Ces infirmières ont d’abord été formées par les religieuses (il faut beaucoup relativiser ce qu’on appelle à cette époque, « formation » d’une » infirmière »). L’influence des religieuses dans un pays à forte proportion catholique, se retrouve dans le style religieux de la tenue portée par ces « infirmières » (par exemple le port du voile).
- IIIème République
L’idée de l’hôpital comme lieu exclusivement consacré aux soins fait son chemin: on ne mélangera plus les malades et les indigents.
Ceci est une conséquence des progrès de la médecine et du développement de l’hygiène hospitalière. La médecine pasteurienne s’oppose aux comportements des religieuses dans les hôpitaux, à commencer par leur tenue, « véritables nids à microbes ». Au début du XXe siècle, la presse médicale présente comme « une grande victoire de la science » le fait que l'hôpital Pasteur soit parvenu à imposer une tenue blanche aux religieuses. Celles-ci se montrent réfractaires aux découvertes de Pasteur ce qui incite les médecins à chercher des auxiliaires « plus dociles ».
- loi laïcité de février 1905,
elle annonce la neutralité religieuse des établissements hospitaliers. En réalité, la laïcisation des hôpitaux et de leurs personnels ne se fera pas selon un processus rectiligne.
* Le cas de Paris :
Dès la fin de la Deuxième République, les effectifs religieux de Paris ne suffisaient déjà plus à faire face aux besoins en personnel soignant. L’Assistance Publique était composée pour un tiers seulement de religieuses. C’est une part bien moins importante que dans le reste du pays.
Par conséquent, Paris a besoin de former des laïques. Sous l’impulsion du médecin anticlérical Bourneville, des cours municipaux pour des femmes laïques font leur apparition (en 1878, à la Salpêtrière). Ils sont fortement critiqués par A. Hammilton et L.Chaptal (cf posts précédents). La laïcisation des hôpitaux de Paris est totalement achevée en 1908.
Il n’en sera pas de même dans toutes les régions et villes de France où la laïcisation se fit à des rythmes différents.
* Le cas de Lille :
La ville doit faire face à une forte densité de la population indigente et elle dispose de peu de moyens financiers. Ici, les arguments des lois anticléricales paraissent irrecevables. Les hôpitaux gardent donc leurs religieuses qui doivent cependant s’adapter en termes de compétences.
http://sylvia.famille-evrard.info/index ... &Itemid=27 ).
D’ailleurs, bien plus tard, en 1927, c’est une école catholique d’infirmières, confiée aux Sœurs Augustines, qui verra le jour à Lille. Les religieuses hospitalières seront présentes à Lille jusqu’en 1991 (départ à la retraite de la dernière sœur, Congrégation des Augustines.)
*Le cas de Lyon :
Au volontarisme parisien, fortement anticlérial de Bourneville s’oppose le pragmatisme gestionnaire d’un Herriot qui s’efforce de conserver les sœurs des Hospices civils de la ville. Le conseil municipal réclame la fermeture de la basilique de Fourvière mais ne voit aucun inconvénient à garder des religieuses dont la qualification est "incertaine" mais qui ne coûtent pas grand’ chose à la ville.
Ainsi, malgré les lois de la séparation Eglises / Etat de 1905, l’administration hospitalière n’est pas partout hostile à la présence des religieuses. Quand un contrat global était passé avec une congrégation, l'affaire pouvait être très intéressante pour l’hôpital et la ville. La somme à dépenser était beaucoup moins élevée que s'il avait fallu payer des salaires à des infirmières laïques. Cette dimension économique a joué un rôle important au sein des hôpitaux provinciaux.
Pas de réponse globale, telle est la situation dépareillée dans laquelle se trouve la France au moment où éclate la Grande Guerre qui va tout bouleverser.
Sources et lectures :
-
Laïciser les hôpitaux : les rythmes de la société et du politique
-
Quelle histoire de l’hôpital aux XXe et XXIe siècles?
- Les hôpitaux après la révolution - ddata.over-blog.com
-
rapport du Conseil économique et Social : "l'hôpital public en France: bilan et perspectives
-
Historique des réformes hospitalières en France
-
L’histoire de la profession des soignants
-
les infirmières: image d’une profession
-
place de l'infirmière dans l'évolution socio-historique des professions de soin
Cordialement
Brigitte
PS: merci Alain pour la lecture, j'ai rajouté le "s" qui a toute son importance à : "loi de séparation deS égliseS et de l'Etat".