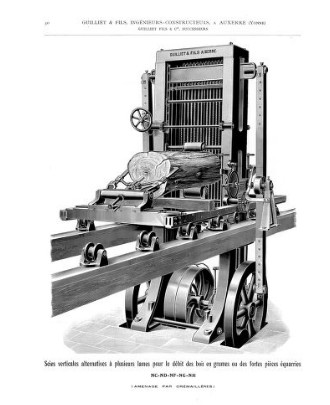Re: obus de 75 bibloc
Publié : jeu. sept. 08, 2016 1:58 pm
Bonjour,
Ces reportages d'époque sont intéressants à plus d'un titre.
Sur les conditions de production, autant l'étroitesse de l'atelier à Bordeaux que le très moderne mais encombré quai de déchargement des papeteries de Lancey (il y a des lopins jusque sur la voie !) laissent penser aux accidents possibles. Il est même étonnant que la censure ait pu laisse passer ces images reflétant un certain amateurisme, mais au pays du système D, on y a plutôt vu le génie d'adaptation national !
A la SA Nouzonnaise on finit au tour des obus déjà forgés, à Lancey on effectue toutes les étapes :
- barres d'acier coupées en lopins
- fours à réchauffer (emboutissage à 1000°, ogivage ou trempe autour de 850°)
- modernes presses hydrauliques (bien plus efficaces que les marteaux pilon) pour les emboutis et ogivages
- batteries de tours pour une vingtaine d'opérations
On est déjà loin du "bibloc" foré avec les moyens du bord !
Bien cordialement,
Régis
Ces reportages d'époque sont intéressants à plus d'un titre.
Sur les conditions de production, autant l'étroitesse de l'atelier à Bordeaux que le très moderne mais encombré quai de déchargement des papeteries de Lancey (il y a des lopins jusque sur la voie !) laissent penser aux accidents possibles. Il est même étonnant que la censure ait pu laisse passer ces images reflétant un certain amateurisme, mais au pays du système D, on y a plutôt vu le génie d'adaptation national !
A la SA Nouzonnaise on finit au tour des obus déjà forgés, à Lancey on effectue toutes les étapes :
- barres d'acier coupées en lopins
- fours à réchauffer (emboutissage à 1000°, ogivage ou trempe autour de 850°)
- modernes presses hydrauliques (bien plus efficaces que les marteaux pilon) pour les emboutis et ogivages
- batteries de tours pour une vingtaine d'opérations
On est déjà loin du "bibloc" foré avec les moyens du bord !
Bien cordialement,
Régis