Bonsoir,
Alain Dubois-Choulik a écrit : ↑mar. oct. 26, 2004 1:36 am
On a déjà parlé (ici ou ailleurs) du mot
boche,
j'ai lu –avec une gaieté contenue [vaguement basé sur Shakespeare] - ces messages sur les noms d’oiseau et je dois avouer que malgré mes 72 ans, je grince encore un peu des dents quand je lis le mot « boche » dans un JMO d'une unité française de la Grande Guerre. Cependant, j'essaie de me convaincre, avec plus ou moins de succès, qu'il s'agit des « Allemands » et non de « nous », les « Bavarois ». En même temps, je pense à « combien de boche » je pourrais encore porter sans m'en rendre compte.
Malheureusement, force est de constater que de telles appellations ne tombent pas du ciel, mais « qu'on les mérite ». Par contre, de l'expérience que j'ai pu acquérir en tant qu'infirmier au début des années 1970 auprès des « vieux guerriers » de 1914-1918, je dois affirmer qu'ils ont beaucoup moins souffert de leur « bocheté » que - par exemple - ma génération ( qui n'en est cependant pas totalement exempte).
Curieusement, je ne suis pas au courant d'une désignation comparable pour les Français dans les histoires régimentaires [bavaroises]. Parfois, on lit le mot « Franzmann/Franzmänner », mais cela n'a pas nécessairement une connotation négative. En bavarois, il n'y a en fait que des termes péjoratifs à partir de cette époque pour le « Breiss’n » [=Prussien] ou pour le « Schurl » ou « Kamerade Schnürschuh » [=Autrichien]. En tant que Bavarois, vous ne vouliez certainement pas finir dans un « paradis prussien » après votre mort, car on dit que les choses y sont réarrangées chaque jour et que vous devez faire des exercices militaires constants.
Maintenant, qui est un vrai « boche » ? Peut-être faudrait-il plutôt parler de « plus-boche » ou de « moins -boche ». Les derniers passages des deux histoires régimentaires pourraient peut-être fournir une base de discussion.
[Fin de l'histoire régimentaire du « königlich preußisches Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 3; Koenigsberg (Prusse-orient)]
(...)
Invaincu sur le champ de bataille, [le régiment] est entré dans l'histoire ; son histoire est sans pareille; ses commandants ont fait de grandes choses, et ses hommes ont accompli des exploits inouïs. La question de Hindenburg s'applique aux deux : « Des êtres terrestres ont-ils vraiment réalisé tout cela ? Ou n'était-ce qu'un conte de fées ou un phénomène fantomatique – le produit d'une imagination humaine excitée ? » Cette loyauté dorée et cette volonté de fer allemande étaient une glorieuse réalité. Elle était, elle reste réelle (...)
[Fin de l'histoire régimentaire du königlich bayerisches Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 2; Munich/Passau]
XXI. Fin.
Lorsque le régiment entre en territoire allemand le 15 novembre [1918], le commandant du régiment fait tenir les parties du régiment qui peuvent être atteintes et emmène le front à l'ouest, en territoire ennemi. Il pensa brièvement aux exploits du régiment et à la loyauté dont il avait fait preuve jusqu'à la dernière bataille. Il a exprimé le souhait que la patrie, sur laquelle dans quelques jours un ennemi insolent posera le pied, chérisse la mémoire de ses simples combattants gris de première ligne. Il ordonna alors : « Enlevez votre casque, priez pour les camarades tombés en terre étrangère ! »
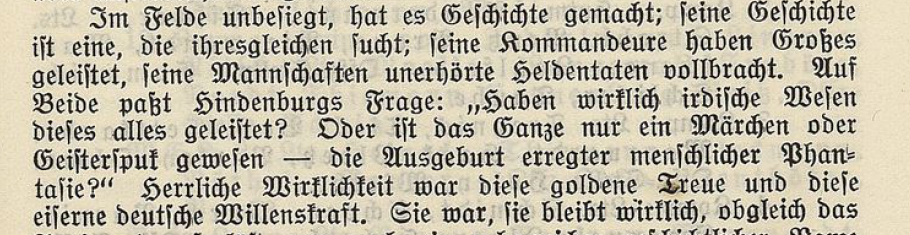
- pr_RIR3_s177_2.png (467.22 Kio) Consulté 1066 fois
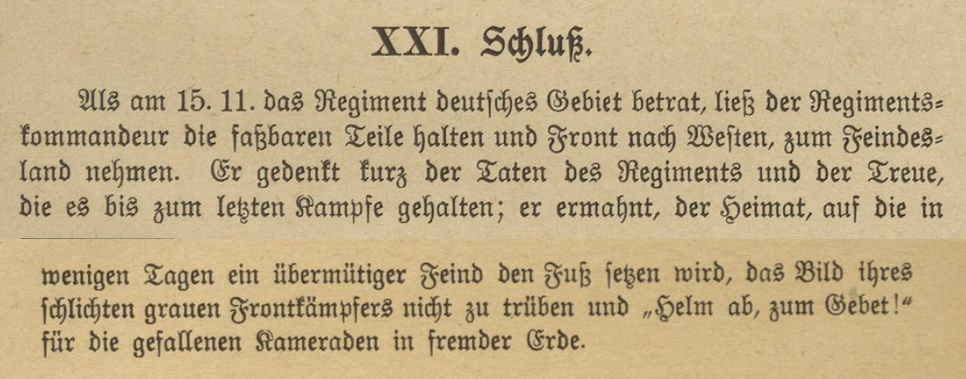
- RG_BAV_RIR2.png (640.81 Kio) Consulté 1066 fois
Enfin, une anecdote du temps de guerre de mon grand-père, qui donne à l'expression française « nom d'oiseau » un équivalent allemand. Fin août 1916, grand-père a combattu à Cléry-sur-Somme aux côtés du 1er régiment de la garde-à-pied prussienne. Les gardes prussiens arrogants ont essayé - comme le disait grand-père - de rendre les Bavarois « stupides » [doofen] ridicules tout le temps. Grand-père s'est battu avec l'un de ces gardes. Lorsque nous, les enfants, lui avons demandé pourquoi il avait fait cela, il a dit : « Il m'a appelé « Lerche » [alouette] ».
Cordialement
Joseph