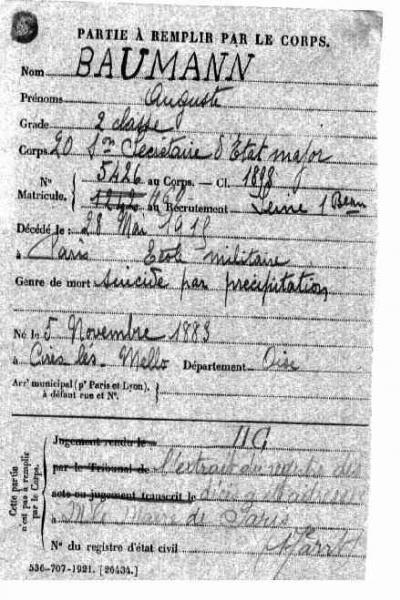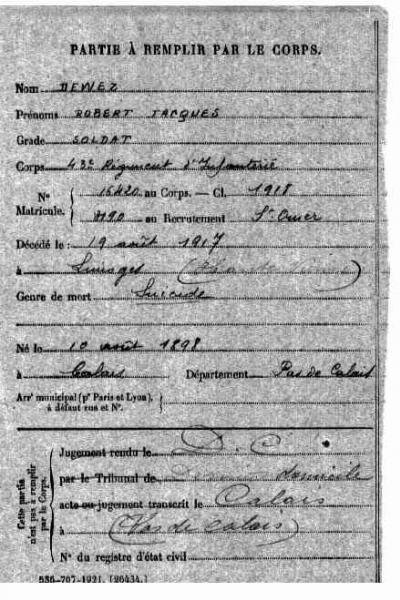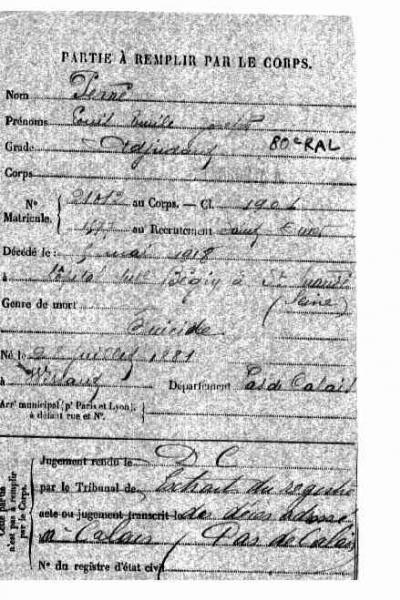Re: Suicides
Publié : ven. juin 29, 2012 12:28 pm
Bonjour à toutes et à tous.
En espérant la clémence des modérateurs, puisque nous sommes hors sujet dans ce forum !!! En effet, le livre du docteur Botte "le suicide dans l'armée" concernent la période qui va de 1878 à 1908.
Voici les conclusions de son travail :
1) Le nombre proportionnel de suicides dans l'armée française est plus élevé que celui de la population civile de même sexe, de même âge et de même état civil.
2) Le suicide dans l'armée est en décroissance continue, celui de la population civile est en progression.
3) Les troupes d'Algérie-Tunisie ont une mortalité-suicide près de deux fois plus forte que celles de l'intérieur.
4) Les officiers se tuent environ une fois et demi, et les sous-officiers deux fois plus que les simples soldats.
Le suicide augmente avec la durée du service, exception faite pour les soldats de moins d'un an de service, qui ont une mortalité plus élevée que ceux qui en ont deux et trois ans.
5) Les corps d'armée de l'intérieur qui donnent la proportion la plus élevée de suicides sont : le 2e (Amiens) et le 5e (Orléans) ; ceux qui donnent la plus basse sont : le 20e (Nancy) et le 17e (Toulouse).
6) La répartition par armes, en dehors de la prédominance marquée des régiments d'Algérie-Tunisie (étrangers, infanterie légère, tirailleurs, spahis etc.), donne en suivant l'ordre de fréquence, le classement qui suit :
La cavalerie a laquelle s'adjoignent les infirmiers et les secrétaires d'état-major et de recrutement; les trains des équipages et les commis ouviers d'administration; l'infanterie de ligne et les chasseurs à pied sur le même rang que la garde républicaine et les prisons, pénitenciers ; les régiments d'artillerie ; enfin en dernier lieu le génie, les sapeurs-pompiers et les ouvriers d'artillerie et artificiers.
7) Les suicides dans l'intérieur sont plus fréquents en été (29,7 %) et au printemps (25,4 %) qu'en hiver (24,2 %) et en automne (20,5 %). En Algérie-Tunisie, la proportion n'est pas la même : été (32,3 %), automne (24,6 %), printemps (22,7 %) et hiver (20,4 %).
8) Le mode de perpétration le plus habituel dans l'armée est le suicide par coup de feu (50 % des cas), puis viennent la pendaison (23 %), la submersion (14,2 %) et la précipitation (5,1 %). A remarquer que dans les suicides civils, le suicide par arme à feu vient bien après la pendaison et la submersion.
9) Le chiffre proportionnel de suicides est plus fort dans l'armée autrichienne, américaine, allemande et italienne que dans l'armée française ; par contre, il est moins élevé dans l'armée belge, anglaise, hollandaise, russe et espagnole.
Les constatations qui ont été faites pour la marche et l'évolution des suicides dans l'armée française sont également vraies pour les autres Etats, de même que leur fréquence suivant les armes, les saisons et les modes de perpétration.
Les causes de suicides diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, ainsi que les craintes des punitions (20 %) et le dégoût du service occasionnent beaucoup moins de suicides dans l'armée française que dans les armées allemande (31 %) et autrichienne (31,9%).
10) En France, l'étiologie principale des suicides militaires est représentée par les chagrins d'ordre privé, les maladies mentales et la crainte des punitions. L'alcoolisme est encore un facteur très important.
11) La prophylaxie du suicide devra donc avoir pour but :
a) De dépister et d'écarter de l'armée les hommes atteints de troubles mentaux, quelque léger que soit leur degré.
b) De lutter contre l'alcoolisme.
c) De développer la surveillance et l'influence morales des supérieurs vis-à-vis de leurs subordonnés.
Bien cordialement,
Denis
En espérant la clémence des modérateurs, puisque nous sommes hors sujet dans ce forum !!! En effet, le livre du docteur Botte "le suicide dans l'armée" concernent la période qui va de 1878 à 1908.
Voici les conclusions de son travail :
1) Le nombre proportionnel de suicides dans l'armée française est plus élevé que celui de la population civile de même sexe, de même âge et de même état civil.
2) Le suicide dans l'armée est en décroissance continue, celui de la population civile est en progression.
3) Les troupes d'Algérie-Tunisie ont une mortalité-suicide près de deux fois plus forte que celles de l'intérieur.
4) Les officiers se tuent environ une fois et demi, et les sous-officiers deux fois plus que les simples soldats.
Le suicide augmente avec la durée du service, exception faite pour les soldats de moins d'un an de service, qui ont une mortalité plus élevée que ceux qui en ont deux et trois ans.
5) Les corps d'armée de l'intérieur qui donnent la proportion la plus élevée de suicides sont : le 2e (Amiens) et le 5e (Orléans) ; ceux qui donnent la plus basse sont : le 20e (Nancy) et le 17e (Toulouse).
6) La répartition par armes, en dehors de la prédominance marquée des régiments d'Algérie-Tunisie (étrangers, infanterie légère, tirailleurs, spahis etc.), donne en suivant l'ordre de fréquence, le classement qui suit :
La cavalerie a laquelle s'adjoignent les infirmiers et les secrétaires d'état-major et de recrutement; les trains des équipages et les commis ouviers d'administration; l'infanterie de ligne et les chasseurs à pied sur le même rang que la garde républicaine et les prisons, pénitenciers ; les régiments d'artillerie ; enfin en dernier lieu le génie, les sapeurs-pompiers et les ouvriers d'artillerie et artificiers.
7) Les suicides dans l'intérieur sont plus fréquents en été (29,7 %) et au printemps (25,4 %) qu'en hiver (24,2 %) et en automne (20,5 %). En Algérie-Tunisie, la proportion n'est pas la même : été (32,3 %), automne (24,6 %), printemps (22,7 %) et hiver (20,4 %).
8) Le mode de perpétration le plus habituel dans l'armée est le suicide par coup de feu (50 % des cas), puis viennent la pendaison (23 %), la submersion (14,2 %) et la précipitation (5,1 %). A remarquer que dans les suicides civils, le suicide par arme à feu vient bien après la pendaison et la submersion.
9) Le chiffre proportionnel de suicides est plus fort dans l'armée autrichienne, américaine, allemande et italienne que dans l'armée française ; par contre, il est moins élevé dans l'armée belge, anglaise, hollandaise, russe et espagnole.
Les constatations qui ont été faites pour la marche et l'évolution des suicides dans l'armée française sont également vraies pour les autres Etats, de même que leur fréquence suivant les armes, les saisons et les modes de perpétration.
Les causes de suicides diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, ainsi que les craintes des punitions (20 %) et le dégoût du service occasionnent beaucoup moins de suicides dans l'armée française que dans les armées allemande (31 %) et autrichienne (31,9%).
10) En France, l'étiologie principale des suicides militaires est représentée par les chagrins d'ordre privé, les maladies mentales et la crainte des punitions. L'alcoolisme est encore un facteur très important.
11) La prophylaxie du suicide devra donc avoir pour but :
a) De dépister et d'écarter de l'armée les hommes atteints de troubles mentaux, quelque léger que soit leur degré.
b) De lutter contre l'alcoolisme.
c) De développer la surveillance et l'influence morales des supérieurs vis-à-vis de leurs subordonnés.
Bien cordialement,
Denis